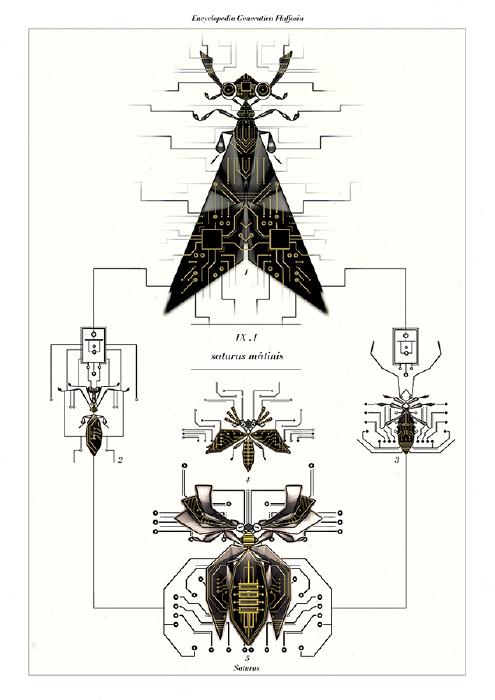Tout au long de l’année 2014 les Mercredis de Thélème contribuent aux commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale avec un cycle intitulé « 1914 en perspective(s) ».
"1914, perspectives artistiques"
avec :
Philippe Chardin, Université François-Rabelais
Didier Girard, Université François-Rabelais
Modératrice : Catherine Douzou , Université François-Rabelais
Philippe Chardin - « je n’ai jamais compris qu’on fît de l’héroïsme pour le compte des autres » : Lucidité et originalité du regard jeté par Marcel Proust sur la première guerre mondiale.
On a tendance aujourd'hui à être sensible aux aspects les plus sulfureux de la vision proustienne de la guerre vue de Paris : sa critique virulente du « bourrage de crâne » ; sa satire mordante du monde de l'arrière ; l'association étroite et inattendue entre guerre et homosexualité à laquelle procède Le Temps retrouvé ; sa sensibilité au caractère funeste, malgré la victoire française, de la destruction du « monde d'hier » tout entier. En même temps À la recherche du temps perdu, roman dans la guerre, extraordinaire exemple d'intégration au sein d'une œuvre déjà largement commencée d'un événement historique considérable survenu inopinément durant la rédaction du livre, reflète, avec son génie et ses visées artistiques propres, les contradictions de l'esprit d'un temps et d'un pays partagés entre exaltation héroïque et dégoût de la guerre.
Ancien élève de l’ENS,
Philippe Chardin est professeur de littérature comparée à l’université François-Rabelais de Tours depuis 1998 et co-responsable du séminaire Proust à l'ITEM. Il a notamment publié : Le Roman de la conscience malheureuse, Genève, Droz, 1983 (« Titre courant », 1998) ; L'Amour dans la haine ou la jalousie dans la littérature moderne, Droz, 1990 ; Musil et la littérature européenne, PUF, 1998 ; Proust ou le bonheur du petit personnage qui compare, Honoré Champion, 2006. Parmi les ouvrages collectifs qu’il a dirigés, trois ont paru aux éditions Kimé : Roman de formation, roman d'éducation dans la littérature française et dans les littératures étrangères en 2007, Originalités proustiennes en 2010 et les Actes du Congrès de la SFLGC 2012 à Tours : L’écrivain et son critique : une fratrie problématique (codirection Marjorie Rousseau) en 2014. Il est par ailleurs l’auteur de romans publiés aux éditions Jacqueline Chambon/Actes Sud (dont Le Méchant vieux temps, 2008) et d’une satire de l’université française (Alma Mater, Atlantica-Séguier, 2000). En rapport direct avec le sujet de la conférence, il a récemment codirigé, aux EUD, avec Nathalie Mauriac, un ouvrage intitulé : Proust écrivain de la Première Guerre mondiale.
Didier Girard - « Crac. Boum. Blast ! » : Vortex, fracas et ruptures dans les revues d’avant garde en 1914.
Cette conférence a pour but de mesurer le volume sonore et esthétique de ces revues qui se sont multipliées au début du 20ème siècle et basées sur de nouvelles pratiques du journalisme culturel et littéraire qui se veulent avant tout des propositions artistiques fracassantes, porteuses de changement et de mutation. Le phénomène ne fut pas concentré en telle ou telle nation en crise, mais dans le vortex de l’Europe au sens le plus large, et dans toutes sortes de langues et de langages.
Le cas et l’orientation idéologique de nombre d’entre elles par rapport à la 1ère guerre mondiale est fort bien connue mais la revue de Wyndham Lewis, d’Ezra Pound et de quelques autres, Blast (dont le tout premier numéro est paru précisément, à un mois près, il y a 100 ans) retiendra particulièrement notre attention car la violence et la destruction n’y sont pas frontalement condamnées ou illustrées mais traitées comme vecteurs indispensables d’une hétérologie furieuse à venir. Hier comme aujourd’hui, un organe d’expression indispensable pour ce que l’on pourrait être tenté d’évoquer par une formule : le terrorisme poétique. Crac, boum, blast !
Professeur de littérature anglophone à l'université François-Rabelais et spécialiste par ailleurs des littératures européennes du 18ème siècle tardif,
Didier Girard est l’auteur d’une thèse sur l’esthétique surréaliste et pop (« Edward James. Poète hypnagogique. » 1995) et a publié articles et/ou éditions critiques à partir des œuvres de Georges Bataille, Leonora Carrington, Salvador Dalí... (voir www.didiergirard.com). Chargé d’édition, traducteur, essayiste publié principalement aux éditions José Corti, Didier Girard vit aujourd’hui à Tours. Parallèlement à ses responsabilités locales, il est également le coordinateur général du premier Doctorat dans le domaine des Humanités sélectionné par la Commission Européenne et labellisé Erasmus Mundus : Interzones. Le consortium international de 16 universités est dirigé depuis l’Université de Bergame, en Italie. www.mundusphd-interzones.eu.
Catherine Douzou est professeur à l’Université François-Rabelais de Tours. Ses recherches portent sur le théâtre, les romans et récits brefs des XXème et XXIème siècles, sur les relations entre littérature, théâtre et arts, et sur les représentations de l'Histoire.